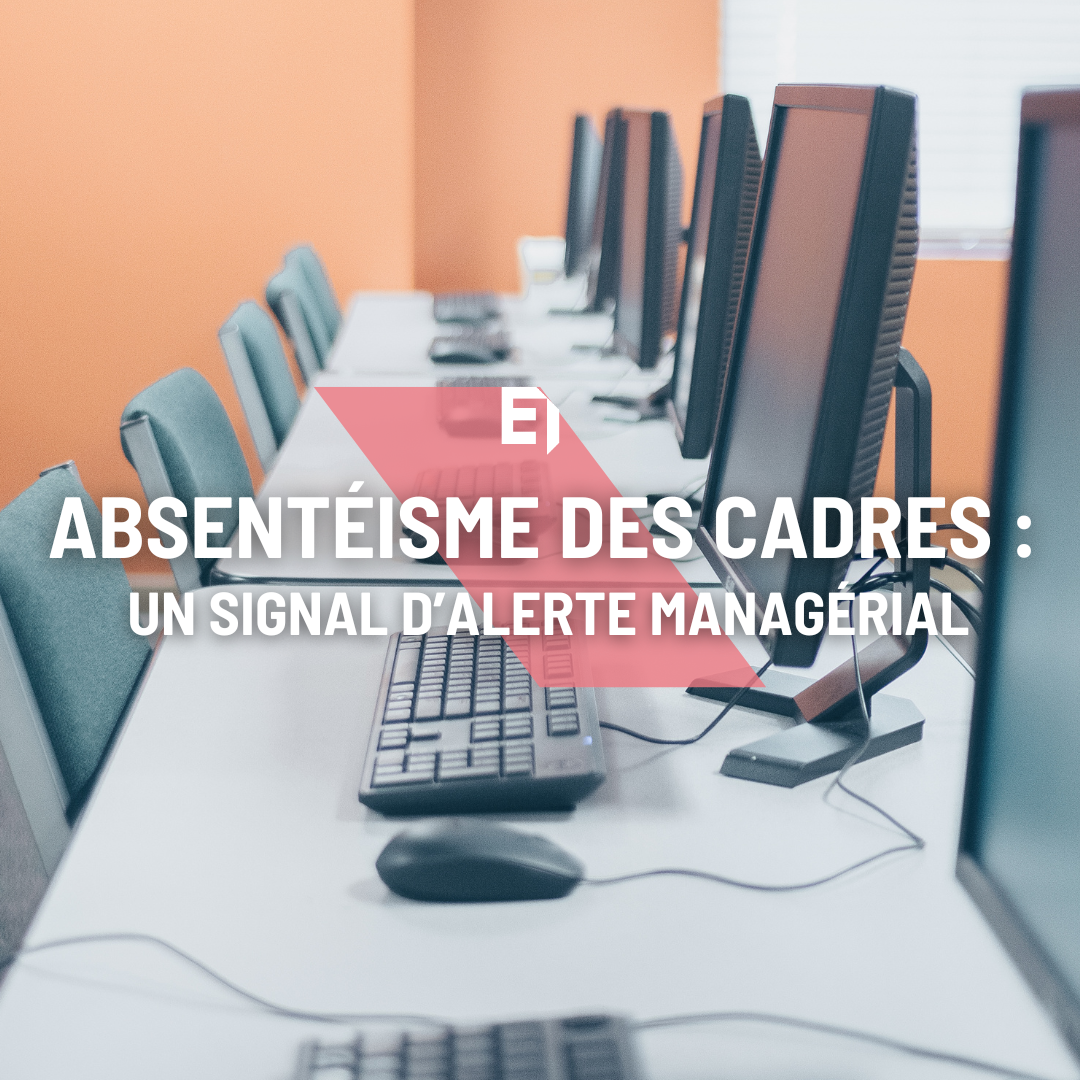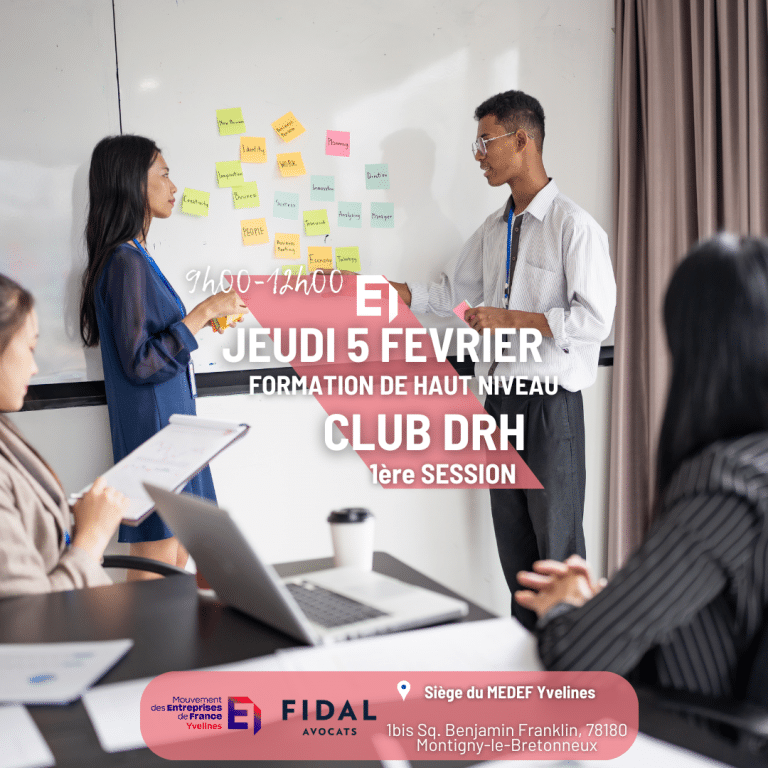L’absentéisme, symptôme des mutations du travail
Si le niveau global d’absentéisme reste en dessous du pic record de 2022, la tendance demeure préoccupante. D’après la 4ᵉ édition de l’Observatoire des arrêts de travail Apicil, le taux moyen en France est passé de 4,27 % à 4,41 % entre 2023 et 2024.
« Les arrêts sont plus nombreux, plus fréquents et plus longs », explique Thomas Perrin, directeur général adjoint du groupe Apicil.
Si les ouvriers restent les plus touchés, les cadres sont désormais de plus en plus concernés, principalement pour des raisons psychologiques. Les troubles psychosociaux ont bondi de +117 % entre 2019 et 2023, selon l’Assurance Maladie.
Ces chiffres traduisent un mal-être diffus, alimenté par des transformations rapides : transition numérique, écologique, démographique… et l’irruption de l’intelligence artificielle, qui bouleverse même les métiers à forte valeur intellectuelle.
Un management en tension permanente
Face à ces absences répétées, les entreprises se désorganisent : surcharge des équipes présentes, stress accru, épuisement, puis démissions.
« Les managers et les RH passent leur temps à réagir dans l’urgence, au lieu de construire des politiques de long terme », observe Thomas Perrin. Cette spirale épuise l’organisation et fragilise sa performance.
Pour endiguer le phénomène, l’entreprise doit repenser sa culture managériale :
reconnaître l’absentéisme comme un indicateur stratégique,
identifier ses causes profondes (organisation, charge mentale, rapport au travail),
favoriser un dialogue sincère et régulier entre managers et collaborateurs.
Renforcer le dialogue managérial et la prévention
Le dialogue managérial reste la première ligne de défense. Mieux écouter, mieux comprendre, mieux aménager : voilà les clés pour prévenir les absences évitables.
Un simple échange peut parfois éviter une rupture : par exemple, un aménagement de télétravail ponctuel, une flexibilité horaire ou un soutien psychologique peuvent suffire à maintenir l’équilibre d’un salarié fragilisé.
Les actions de prévention doivent aussi être repensées :
formation des managers à la détection des signaux faibles,
accompagnement des retours d’arrêts longs,
valorisation de la santé mentale au même niveau que la performance.
Un enjeu durable pour les entreprises
Si la durée moyenne des arrêts (19,85 jours) se stabilise, les absences de longue durée et les micro-absences progressent. Le constat est clair : le sujet n’est plus marginal, il devient structurel.
Les secteurs les plus touchés restent la santé, l’économie sociale et l’éducation (5,68 %), tandis que les services aux entreprises restent en deçà (3,29 %).
Pour les dirigeants, il s’agit désormais d’intégrer l’absentéisme dans la stratégie globale de performance, au même titre que la productivité ou la fidélisation des talents.