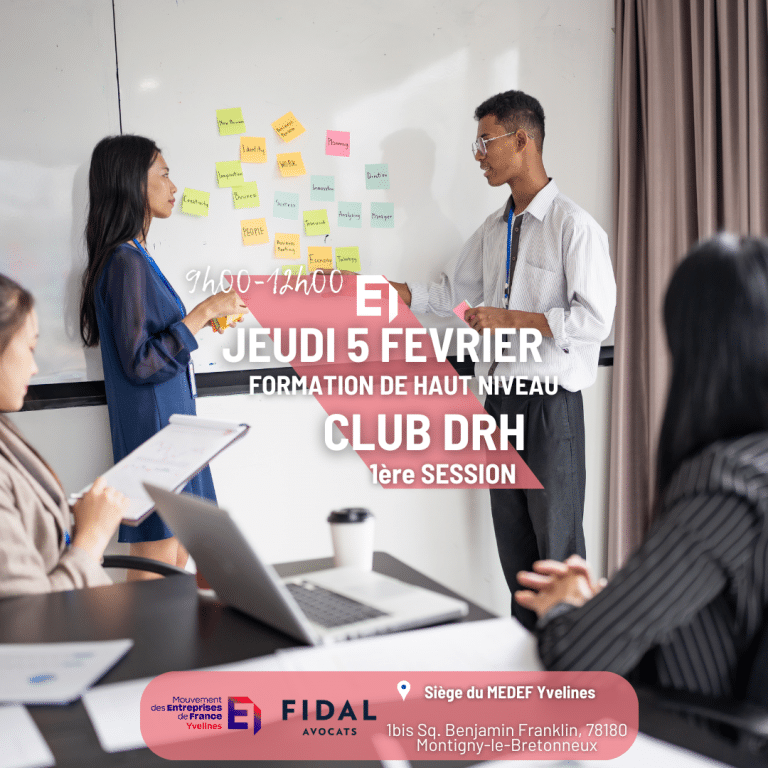Le Céreq a publié, le 11 juillet 2025, un Bref intitulé « Avoir un rôle de tuteur en entreprise : un travail qui ne va pas de soi » (n° 473). Cette étude met en lumière l’importance croissante du tutorat, tout en soulignant ses limites actuelles dans les pratiques RH.
La professionnalisation du tutorat, un levier sous-exploité
En 2021-2022, plus d’un salarié sur quatre déclarait avoir exercé une fonction de tuteur ou de formateur.
Ces salariés, souvent en milieu de carrière, jouent un rôle clé dans la transmission des savoirs, l’intégration et la professionnalisation, en particulier pour les alternants. Pourtant, le tutorat reste perçu comme une tâche « en plus », rarement reconnue dans les parcours professionnels ou les classifications.
Les tuteurs se recrutent majoritairement parmi les cadres et professions intermédiaires, moins parmi les employés et ouvriers. Leur engagement décline avec l’âge, notamment après 55 ans.
L’étude souligne également que les conditions d’exercice varient fortement selon les entreprises : certaines accompagnent et valorisent le rôle, d’autres l’assignent sans soutien ni temps dédié.
Pour le Céreq, le tutorat nécessite une véritable professionnalité : capacité pédagogique, gestion du temps, accompagnement individualisé. Or, ces compétences sont rarement formalisées ou reconnues. L’absence d’outils, de formation des tuteurs et de dispositifs de valorisation fragilise l’efficacité du tutorat.
Dans un contexte de réforme emploi-seniors et de tensions sur les compétences, le tutorat pourrait devenir un levier central de gestion intergénérationnelle et de fidélisation. Le Céreq recommande de mieux l’intégrer aux politiques RH :
inscrire le tutorat dans les plans de développement des compétences ;
reconnaître le rôle des tuteurs dans les évolutions de carrière ;
aménager la charge de travail et prévoir des incitations adaptées.
Un rappel utile : la transmission des savoirs ne s’improvise pas. Le tutorat, pour être efficace, doit être pensé comme une mission structurée et valorisée.